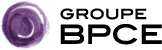« Pouvez-vous m’aider à choisir mon statut juridique ? » C’est une question posée par beaucoup d’entrepreneur·e·s qui franchissent les portes de BGE. SARL, SAS, SASU, micro-entreprise ? Outil au service du projet, le statut juridique ne doit être choisi qu’après avoir posé les bases essentielles de l’activité.
Avant de vous lancer dans les réflexions sur votre statut, assurez-vous donc de vous être posé les cinq questions suivantes !
Suis-je prêt à être entrepreneur·e ?
Avant même de vous interroger sur le statut juridique possible de votre entreprise ou sur la viabilité économique de votre projet, la première question à vous poser, c’est celle de l’adéquation entre votre projet entrepreneurial et votre réalité. Non seulement faut-il vous demander si vous est prêt à devenir chef d’entreprise – avec tout ce que cela implique en termes de responsabilités, de charge mentale, d’administratif ou d’incertitude – mais il est tout aussi important de vous assurer que le projet en lui-même correspond à votre mode de vie, à vos contraintes, à vos valeurs et à vos envies.
Suis-je prêt à me lever tous les matins aux aurores pour enfourner le pain si j’ouvre une boulangerie ? Suis-je prêt à travailler debout toute la journée, à enchaîner les rendez-vous et à entretenir une relation client constante, même en étant fatigué, si j’ouvre un salon de coiffure ? Suis-je capable de gérer le stress des périodes creuses, de démarcher régulièrement des clients, de travailler sur plusieurs projets en parallèle en respectant des délais serrés si je veux devenir graphiste freelance ?
Une fois que l’on s’est assuré que le projet est en adéquation avec ses attentes et ses contraintes, alors on peut entrer dans l’analyse de sa viabilité.
Mon idée répond-t-elle à un réel besoin sur le marché ?
C’est la question fondamentale pour toute entreprise. Il ne suffit pas d’avoir une bonne idée, encore faut-il qu’elle réponde à un besoin. Avant toute démarche administrative, il est donc essentiel de s’assurer qu’il existe une demande pour le produit ou le service envisagé. Pour ce faire, l’étude de marché est la première étape, car elle permet d’analyser la concurrence, de comprendre les attentes des clients et d’identifier les opportunités et les menaces. Cette étape est essentielle, car un projet sans marché ne peut pas créer de la valeur, et ce quel que soit le statut juridique choisi.
Comme l’explique Valérie Savouré, conseillère-formatrice chez BGE Yvelines, « l’objectif de cette étude est de valider qu’il y a un marché et qu’il y a une place pour vous sur ce marché, avec une plus-value différenciante par rapport à vos concurrents. » Pour faire cette étude de marché, elle recommande « d’aller rencontrer des prescripteurs, des partenaires, des professionnels, des prospects qui vont vous donner de l’information sur le besoin du client et vous permettre d’avoir une offre en réelle adéquation avec le besoin du client. »

J’ai écouté l’intervenant de BGE Sud-Ouest, ce qui m’a fait prendre conscience que je n’étais pas aussi prêt que je le pensais. Je n’avais pas fait d’étude de marché, ni de business plan complet. Ça m’a donné envie d’en savoir plus. J’ai finalement choisi de retarder de 6 mois la création de l’entreprise pour être suivi par un conseiller-formateur. […] L’accompagnement BGE m’a beaucoup aidé à y voir plus clair et à structurer mon dossier. J’ai préparé une étude de marché pour m’assurer que l’entreprise soit viable et que je proposais le bon prix de vente.
Copeaux et Paillettes
Ai-je défini un modèle économique viable ?
Avant de vous concentrer sur les aspects juridiques, vous devez aussi déterminer précisément comment votre entreprise va gagner de l’argent. Qu’allez-vous vendre, à qui, dans quel but, de quelle manière et pour quel bénéfice ? Un modèle économique, ou business model, ne se résume pas à l’anticipation de la vente d’un produit ou d’un service : il implique de définir une stratégie commerciale, d’identifier les canaux de distribution, d’estimer les coûts et de calculer la rentabilité du projet. Ce travail permet aussi d’identifier les besoins en trésorerie, les périodes de creux éventuelles et les seuils de rentabilité.

Nous avons suivi un parcours d’accompagnement de 6 semaines avec des formations qui nous ont permis d’apprendre comment travailler son modèle économique, faire une étude de marché, monter un business plan solide pour avoir un prévisionnel fiable. Ça nous a vraiment permis de structurer notre projet et d’acquérir des compétences-clés en tant qu’entrepreneurs.
Annagram
Comment vais-je financer mon projet ?
Certaines entreprises peuvent démarrer avec peu de moyens – un ordinateur et une bonne connexion suffisent parfois. D’autres, au contraire, nécessitent un capital de départ conséquent : achat de matériel, aménagement de locaux, constitution de stock, etc. Dans tous les cas, il vous faudra définir clairement les besoins de financement et les solutions possibles : apport personnel, prêt bancaire, prêt d’honneur, subventions…
📰 Financer mon entreprise : découvrez les conseils de nos experts
Réaliser un prévisionnel financier permettra notamment d’estimer les financements nécessaires au démarrage comme au développement de l’activité. Or, le mode de financement envisagé influencera le choix du statut juridique. Si vous souhaitez solliciter un prêt ou faire entrer des associés, une forme sociétale sera plus adaptée qu’un statut micro-entrepreneur. À l’inverse, si vous créez une activité secondaire sans ambition de développement et qui nécessite peu de moyens, la micro-entreprise peut être envisagée.

La partie la plus compliquée a été d’établir un prévisionnel, c’était difficile car la plupart des fournisseurs refusent de donner des prix à des particuliers, donc je n’ai pas eu accès à certaines informations tant que je n’étais pas immatriculé. Cela réglé, j’ai pu établir un business plan solide qui m’a permis par la suite de trouver facilement un banquier prêt à me suivre pour financer mon projet. Ça aussi, ça a été facilité par BGE car il y avait régulièrement des rencontres avec des intervenants : avocats, banquiers, assureurs…
My Concept Van
Quelle est la réalité réglementaire de mon activité ?
Dernier point, souvent négligé : chaque secteur a ses propres contraintes. Certaines professions sont réglementées et exigent des diplômes, des assurances, voire des autorisations spécifiques. D’autres impliquent des responsabilités lourdes, qui justifient de séparer ses biens personnels de ses risques professionnels.
Les professionnels du bâtiment se doivent par exemple de souscrire une assurance de responsabilité décennale, tout professionnel du bâtiment étant tenu responsable des dommages, pour les travaux de gros œuvre et de second œuvre, qui peuvent apparaître sur l’ouvrage qu’il a réalisé. Tout cela doit être su et anticipé pour choisir son statut juridique et, au besoin, protéger son patrimoine.

Notre projet premier était de faire des cosmétiques qui ressemblaient à des pâtisseries. Comme on était entre la réglementation cosmétique et la réglementation alimentaire, on n’a pas pu valider nos produits et on a donc dû pivoter et changer certains aspects pour pouvoir faire avancer le projet.
Les Maronneuses
Choisir un statut juridique n’est pas le point de départ de la création d’une entreprise, mais bien l’aboutissement d’un processus de réflexion plus large qui aura permis de définir les contours du projet. Une fois faites l’étude de marché, rédigé le prévisionnel financier, étudiées les réglementations de l’activité, alors la réponse devient plus simple à trouver.
Créer un business solide et une entreprise pérenne
Se lancer, c’est bien. Construire un projet durable, c’est encore mieux ! Dans cette vidéo, découvrez comment ces entrepreneur·e·s ont su bâtir leur succès en développant des stratégies commerciales adaptées à leur marché.