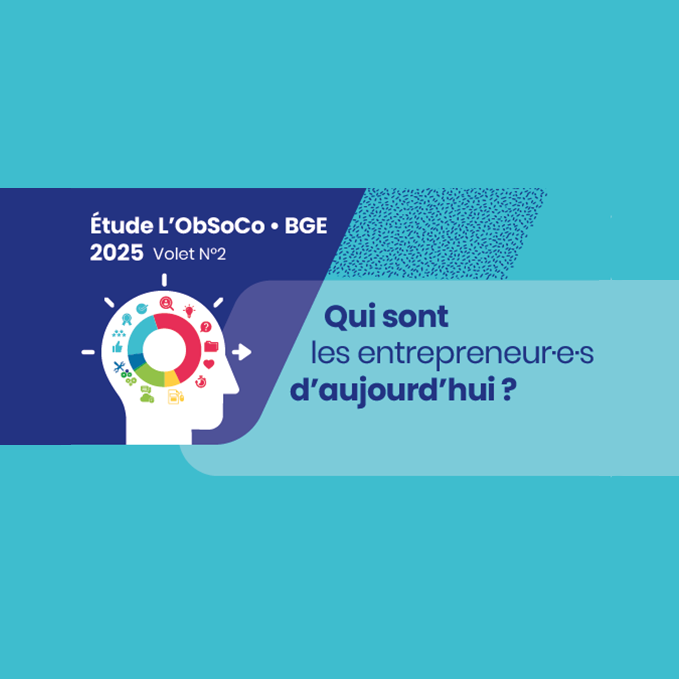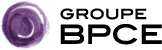Avec cette étude d’ampleur, initiée en 2022 et enrichie en 2025, BGE a cherché à présenter et illustrer la réalité entrepreneuriale et ses mutations pour obtenir une vision plus nuancée, incluant une démarche inédite de segmentation et de définition de familles d’entrepreneurs.
L’étude Qui sont les entrepreneur·e·s d’aujourd’hui ? a été réalisée par L’ObSoCo (L’Observatoire Société & Consommation) sur un échantillon de près de 10 000 personnes s’étant ou non immatriculées après leur accompagnement chez BGE.
Découvrir les résultats de l'étude Télécharger le communiqué de presse
Echange avec Guénaëlle Gault, directrice générale de l’ObSoCo
Qu’apporte cette enquête de nouveau ou de différent par rapport aux données existantes sur l’entrepreneuriat ?
Ce dispositif se distingue par son approche longitudinale unique, suivant les porteurs de projet sur plusieurs années après leur accompagnement, ce qui permet de mesurer la réalité du passage à l’acte entrepreneurial au-delà des intentions initiales. C’est également une approche holistique qui analyse l’entrepreneuriat sous tous ses angles : dimensions économiques, sociologiques mais aussi psychologiques.
Contrairement aux statistiques qui se focalisent sur les immatriculations ou les défaillances, nous mesurons les faits mais analysons aussi le vécu subjectif de l’entrepreneuriat : le sentiment de réussite, la complexité perçue, l’écart entre attentes et réalité. L’innovation majeure réside dans la segmentation des entrepreneur·e·s, qui révèle que le succès entrepreneurial ne dépend pas uniquement des ressources économiques ou du niveau de formation, mais aussi de dimensions psychologiques comme le sentiment de maîtrise, la tolérance au stress, la capacité à sortir de sa zone de confort ou encore celle de savoir s’entourer.
Peut-on constater des évolutions majeures entre les deux volets de l’étude ?
Entre 2023 et 2025, on observe un taux de création relativement stable (à 33%). Mais on voit bien que l’exercice entrepreneurial a connu un durcissement. Cela se traduit par une détérioration des indicateurs de satisfaction et de confiance pour les projets en difficulté, indiquant une plus forte polarisation de la réussite. Cette polarisation suggère que l’entrepreneuriat devient de plus en plus clivant entre ceux qui disposent des bonnes ressources psychologiques et économiques et les autres.
Ce contexte difficile se traduit également par une augmentation du nombre de créateurs dont le chiffre d’affaires est jugé inférieur à leurs attentes mais aussi par une augmentation des projets non lancés qui sont désormais complètement abandonnés. Pour les non-créateurs, les freins principaux restent l’incertitude quant à la viabilité/rentabilité du projet et le manque de financement mais l’on sent davantage l’incapacité croissante des porteurs de projets à surmonter ces obstacles. Cette seconde vague témoigne d’un environnement économique et psychologique plus exigeant pour les entrepreneur·e·s et une importance accrue du soutien psychologique et de la résilience dans la durée.
En quoi l’approche par la segmentation des profils entrepreneuriaux est utile/pertinente dans cette démarche d’étude ?
L’approche par segmentation renouvelle profondément la compréhension de l’entrepreneuriat. Elle dépasse la vision binaire entre créateurs et non-créateurs pour mettre en évidence la diversité des trajectoires, des motivations et des besoins. Elle montre surtout qu’un accompagnement efficace doit être différencié, adapté à l’état d’avancement du projet et au profil psychologique de chaque individu.
Chez les créateurs, les besoins varient fortement selon leur trajectoire. Pour ceux qui sont en phase de réussite (les « Certains »), la priorité est la consolidation : accéder à des réseaux qualifiés, recruter, structurer leur croissance. Leur accompagnement doit donc viser le passage à l’échelle.
Les « Optimistes », en revanche, traversent une période charnière. Malgré leur motivation intacte, ils jugent difficile de pérenniser leur activité et déplorent un chiffre d’affaires en retrait. Ils ont besoin d’un soutien technique et financier immédiat pour franchir ce cap sans s’essouffler.
Les « Incertains », bien qu’ils obtiennent des résultats corrects, peinent à se projeter. Leur accompagnement doit les aider à planifier, à se fixer des objectifs clairs et à sécuriser leur trajectoire. Enfin, les « Déçus » se trouvent dans une situation critique. Ils nécessitent une double intervention : réévaluation du modèle économique et soutien psychologique pour restaurer un sentiment de contrôle, aujourd’hui largement effondré.
Chez les non-créateurs, la segmentation met également au jour des profils très différenciés. Les « J’y suis presque » disposent déjà des qualités clés — créativité, leadership, gestion du stress — mais restent bloqués par des obstacles concrets : le manque de financement ou la lourdeur administrative. L’enjeu, pour eux, est de lever ces freins pratiques pour faciliter le passage à l’acte.
Les « Ni oui ni non » incarnent la prudence : ils hésitent à se lancer par peur du risque et difficulté à gérer le stress. Leur accompagnement doit avant tout être décisionnel et émotionnel, centré sur la réassurance et la gestion de l’incertitude. Les profils « Non merci » vont finalement avoir besoin que l’on valorise cette expérience et recrée des passerelles avec le monde du salariat.
Cette approche révèle donc que les besoins entrepreneuriaux ne sont pas uniformes mais profondément différenciés. La clé réside dans une approche personnalisée, qui dépasse la logique de moyens — formation, financement, dispositifs génériques — pour privilégier une logique d’adaptation et de développement des compétences propres à chaque profil. C’est à cette condition que l’accompagnement entrepreneurial peut réellement renforcer les chances de réussite de chacun.
Cette étude interroge les motivations à entreprendre et l’évolution de la relation au travail, est-ce que vous voyez des échos avec des constats que vous faites dans d’autres études récentes sur l’évolution de notre société ?
L’aspiration à l’indépendance et à éviter le salariat comme première motivation entrepreneuriale qui continue à se renforcer (37% des porteurs de projet, + 6 points par rapport à 2023) fait écho à la quête d’autonomie que nous observons dans toutes nos études sur le rapport au travail mais plus globalement dans notre société individualisée. De même que la forte proportion (18%) de projets motivés par l’envie d’être utile et contribuer au bien commun illustre le besoin croissant d’alignement entre valeurs personnelles et activité professionnelle.
Mais le taux important de personnes n’ayant pas lancé leur projet (67%) et, parmi eux, ceux qui ont abandonné (36%) reflète également la tension entre l’idéal d’émancipation par l’entrepreneuriat et la réalité de la précarité qu’il peut engendrer. Nous retrouvons ici le paradoxe contemporain : une société qui survalorise l’initiative individuelle et l’autonomie mais n’en donne pas toujours les moyens. Dans ce contexte, l’entrepreneuriat peut devenir un révélateur des inégalités de capital psychologique, social et économique. D’où l’importance cruciale de l’accompagnement, qui constitue souvent la clé pour transformer un désir d’autonomie en émancipation véritable et trajectoire durable.
L’ObSoCo (Observatoire Société & Consommation) est une société d’études et de conseil en stratégie née de la conviction que nous vivons actuellement une période de transformation profonde de la société, de l’économie et du commerce.